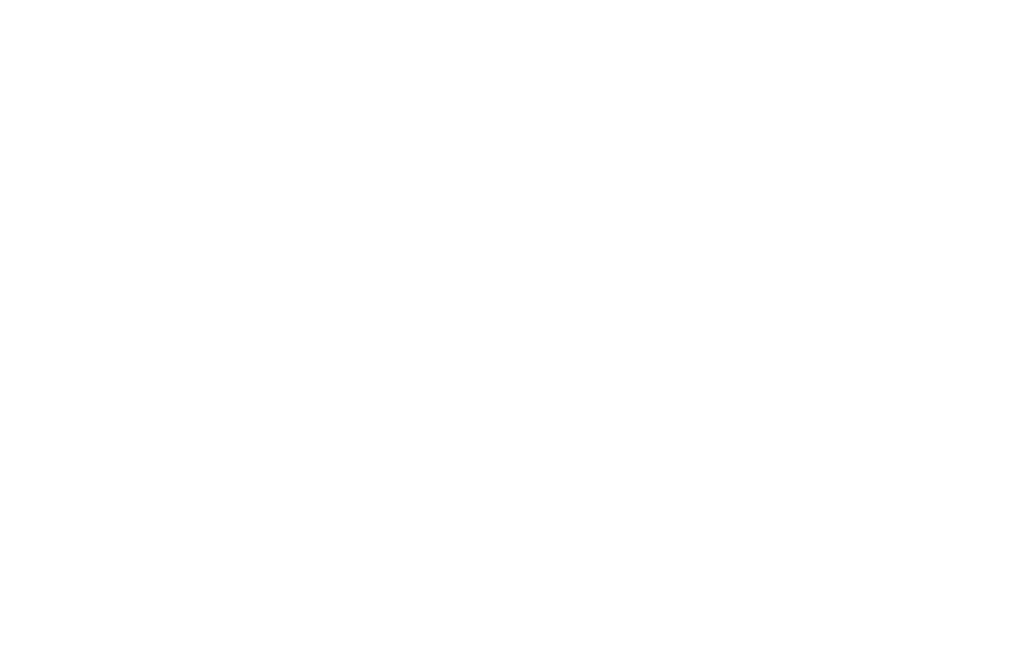La formation se déroule en 2 parties distinctes et autonomes :
LES OUTILS DE LA DRAMATURGIE
Cette partie permet aux stagiaires d’acquérir l’ensemble des notions et outils de dramaturgie, indispensables à l’écriture de scénarios. Sont traités en détail les thèmes suivants :
Introduction
• Le rôle du scénariste et son positionnement : film expérimental ou film à récit ?
• Les contraintes d’écriture : écrire pour l’image, pour les spectateurs, pour un marché.
• Le besoin de sens et d’émotions du spectateur.
• Les bases de la dramaturgie : un début, un milieu, une fin.
Le conflit, cœur de toute œuvre dramatique
• Définition des conflits : interne/externe, passif/dynamique, présent/en perspective.
• Rôle et fonction du conflit : enjeu et identification du spectateur.
• Comment écrire de manière conflictuelle ?
Les prémisses de l’histoire
• L’arène narrative : l’univers dans lequel évolue le récit. • La situation initiale et la routine du protagoniste.
• Le protagoniste idéal pour porter l’histoire.
• L’élément déclencheur qui lance l’aventure.
• Approches théoriques françaises et américaines.
La caractérisation des personnages
• L’identification du spectateur à travers les personnages.
• Degrés de caractérisation selon le genre du film.
• Éléments de caractérisation : passé, présent, futur.
• Psychologie des personnages et rôle du conflit dans leur construction.
• Le spectre du passé influençant le présent.
• Traits de caractère dominants et nuances.
• Transformation des personnages : une question de genre et de philosophie.
Le cœur de l’histoire : enjeux et obstacles
•Objectifs conscients et inconscients du protagoniste.
• Motivations et enjeux : qu’a-t-il à perdre ?
•Moyens mis en œuvre pour atteindre l’objectif.
•Obstacles et défis rencontrés.
•Noeuds dramatiques : relancer l’action, créer de l’urgence et du suspens.
Le climax et la fin de l’histoire
•La montée en tension jusqu’au climax.
•Définition du dénouement et résolution de l’histoire.
•Différentes fins : happy-end, tragique, nuancée.
•Les structures alternatives : fausses fins, coups de théâtre.
•La gestion du suspens et du compte à rebours.
• La fin en lien avec le point de vue de l’auteur.
La place du spectateur dans le processus narratif
Le spectateur, partenaire officiel du processus narratif.
La préparation et le paiement.
L’ironie dramatique / La surprise / Le mystère.
La nécessité de clarté (des personnages et des éléments de l’intrigue).
Le suspens qui fait participer consciemment le spectateur.
Le sous-texte qui fait participer inconsciemment le spectateur.
Structurer son histoire
Les mêmes éléments de dramaturgie pour une multitude de structures possibles. La structure qui vient de l’intérieur et non de l’extérieur. La place et le rôle de (ou des) sous-intrigue(s) dans une histoire.
La scène et le dialogue
• Structure d’une scène : début, milieu, fin.
• L’importance du conflit dans les scènes.
• L’évolution de la « température » d’une scène.
• Les liens entre les scènes.
• Dialogues : bon vs mauvais dialogue.
• Dialogue et caractérisation des personnages.
• Dialogue et transmission d’informations.
• Dialogue, sous-texte et musicalité.
Présenter et vendre son projet
•Le pitch dramatique : protagoniste, objectif, promesses de conflit.
•Le synopsis.
•Le traitement.
•La continuité dialoguée.
•La note d’intention de l’auteur..
Présenter et vendre son projet
•Le pitch dramatique : protagoniste, objectif, promesses de conflit.
•Le synopsis.
•Le traitement.
•La continuité dialoguée.
•La note d’intention de l’auteur.
Bilan de la partie théorique et lancement des projets individuels
Tour de table des participants / Questions et bilan. Choix des projets qui seront développés dans le cadre de l’atelier.
DEUXIEME PARTIE : 120 HEURES
ATELIER DE DÉVELOPPEMENT DES PROJETS PERSONNELS
Cette deuxième phase vise à mettre en application les principes de dramaturgie appris lors de la première partie et à accompagner les stagiaires dans le développement de leur projet de long métrage. Sous la supervision du formateur référent, chaque participant bénéficie d’un suivi personnalisé et d’un travail en atelier collaboratif.
Objectifs de l’atelier
Les stagiaires auront pour but de produire :
• Soit un traitement (voire une continuité dialoguée) d’un court-métrage.
• Soit un synopsis détaillé d’un long-métrage, accompagné d’une note d’intention et, selon l’avancement du projet, de séquences dialoguées.
La formation alterne :
– Écriture en atelier, favorisant l’interaction et les retours constructifs.
– Séances d’écriture individuelles, ponctuées d’entretiens personnalisés avec le formateur référent.
Déroulement de l’atelier
L’atelier se structure en plusieurs phases progressives :
1. Définition du projet et mise en place des bases
– Cahier des charges dramaturgique : chaque stagiaire remplit un document guidé pour préciser son intention d’auteur, son sujet, on point de vue, ainsi que les bases de son intrigue (personnages, enjeux, obstacles, dénouement, transformation éventuelle des personnages…).
– Atelier collectif : tour de table où chaque participant présente son projet et reçoit des retours du formateur et des autres stagiaires.
2. Affinement progressif du projet
Les séances suivantes, sous forme d’entretiens individuels, permettent d’approfondir :
• L’intention de l’auteur et le message du film.
• La caractérisation des personnages et leur arc narratif.
• La structure dramatique et la progression de l’intrigue.
Thèmes abordés durant l’accompagnement :
Analyse globale du projet
• Origine et genèse du projet.
• Sources d’inspiration et enjeux narratifs.
• Choix du genre et du ton du film.
• Définition du thème central et du point de vue de l’auteur.
• Contexte et pertinence du sujet aujourd’hui.
• Impact potentiel sur le public.
Choix et caractérisation des personnages
• Définition du protagoniste, de l’antagoniste et de l’enjeu qui les oppose.
• Motivations, but et trajectoire des personnages.
• Analyse de leurs conflits internes et externes.
• Développement de leur singularité et de leur psychologie.
• Étude des interactions et dynamiques relationnelles.
Construction dramatique et structuration du scénario
•Identification du conflit dramatique central et des intrigues secondaires.
•Structuration des nœuds dramatiques, obstacles et péripéties.
•Étude de la progression dramatique et du rythme narratif.
•Analyse de la construction des scènes et de leur enchaînement.
•Élaboration du séquencier.
•Recherche de solutions aux éventuels blocages narratifs..
Les dialogues et le langage cinématographique
• Maîtriser la spécificité des dialogues pour le cinéma.
• Trouver le bon équilibre entre dialogue et sous-texte.
• Donner du rythme et de la fluidité aux dialogues.
Pitch devant un producteur.
En présence du formateur référent, chaque stagiaire présente son projet face à un producteur de long métrage.
L’objectif de cette validation est de pouvoir mesurer les progrès accomplis et de valider l’avancée du développement (structure dramatique, force des personnages, cohérence des dialogues etc).
Bilan de la formation
Après le face à face avec le producteur, le formateur référent s’entretient une dernière fois avec les stagiaires. D’abord à l’intégralité du groupe pour débriefer de l’entretien avec le producteur, puis individuellement pour réfléchir sur les pistes de travail à envisager pour continuer son développement après la formation.
Matériel utilisé / Supports pédagogiques
- extraits de films et de scénarios,
- fiches de lecture et d’évaluation de scénarios,
- exemples de synopsis, de traitements, de notes d’intention, de continuités
- Un poste de travail iMac 5, 17 ou 20 pouces, par stagiaire